
Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunit ce 30 octobre pour renouveler le mandat de la MINURSO et examiner un projet de résolution américain qui pourrait redéfinir les paramètres du dossier du Sahara occidental.
Le texte, soutenu par l’administration Trump, entend placer le plan d’autonomie marocain de 2007 au cœur du règlement politique, tout en réaffirmant — sous la pression de plusieurs délégations — le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément à la Charte des Nations unies.
Cette inflexion marque une étape charnière. Pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis ne se contentent pas d’une position de médiateur, mais assument une ligne stratégique : celle d’un réalisme diplomatique qui considère que la stabilité régionale prime sur la confrontation idéologique. Dans un contexte où le Maghreb et le Sahel sont en pleine recomposition géopolitique, Washington veut imposer une solution « pragmatique », susceptible de rapprocher les positions antagonistes sans relancer le cycle de tensions armées.
Un texte américain aux contours politiques assumés
Présenté le 22 octobre, le projet de résolution qualifie le plan marocain d’« autonomie au sein de l’État marocain » de « solution la plus réalisable », voire de « base unique de discussion ». Une formulation qui, bien que révisée par la suite, traduit la volonté américaine de verrouiller le débat autour d’un cadre unique.
Sous l’impulsion du Département d’État et du cercle stratégique de Donald Trump, l’idée est de faire de l’autonomie un instrument de pacification, tout en évitant les références explicites à un référendum d’indépendance, jugé « inapplicable » depuis plus de trente ans.
Face aux réserves exprimées par l’Algérie, la Russie et plusieurs États africains, une version modifiée a réintroduit la mention du « droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même », une concession nécessaire pour éviter un veto.
Mais l’équilibre demeure fragile : en inscrivant l’autonomie comme horizon privilégié, les États-Unis cherchent à forcer un basculement doctrinal au sein des Nations unies, d’un paradigme décolonisateur figé vers un cadre de gouvernance négociée.
Ce virage s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en décembre 2020, décision qui avait ouvert la voie à une série d’alignements diplomatiques : l’Espagne, la France et le Royaume-Uni ont depuis exprimé leur soutien explicite ou implicite à la proposition de Rabat.
Une offensive diplomatique coordonnée
De Rabat à Washington, la diplomatie marocaine a mené, ces derniers mois, une campagne d’une intensité rare.
Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a multiplié les échanges bilatéraux : Panama, Sierra Leone, Somalie, Slovénie, Corée du Sud, sans oublier les entretiens à Paris, Pékin et Moscou.
Cette stratégie d’alliances croisées vise à consolider un bloc majoritaire autour de la résolution américaine.
Dans l’ombre, la France et le Royaume-Uni ont appuyé Rabat par une diplomatie « affinitaire », activant leurs réseaux européens et du Commonwealth, tandis que les États-Unis orientaient leurs efforts vers Islamabad, Séoul et Ljubljana.
Dans le même temps, le Maroc a actualisé son projet d’autonomie en consultant les diplomaties française, britannique et espagnole. Des recommandations inspirées de la Polynésie française, de l’Écosse et des communautés autonomes d’Espagne ont été soumises à Rabat.
Cette démarche suggère un modèle hybride : une autonomie élargie sous souveraineté reconnue, avec des garanties internationales et un haut niveau d’autogestion locale.
L’émergence du MSP : la voix sahraouie du réalisme
C’est dans ce contexte de recomposition que le Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP) s’affirme comme un acteur incontournable.
Fondé en 2020 par des anciens cadres du Front Polisario issus des camps de réfugiés de Tindouf et de la diaspora sahraouie, le MSP propose une troisième voie : celle du dialogue, du compromis et de la légitimité populaire.
Le mouvement revendique une présence active à Laâyoune, Dakhla, Smara, Nouadhibou, Nouakchott et dans plusieurs capitales européennes, où il mobilise une grande partie des Sahraouis désireux de tourner la page de l’exil et du statu quo.
Sous la direction de Hach Ahmed Baricalla, le MSP défend une approche fondée sur trois principes :
* La reconnaissance des réalités sur le terrain — le Maroc administre déjà plus de 80 % du territoire ;
* La participation directe des Sahraouis à la négociation — aucune solution ne peut être imposée sans leur voix ;
* L’équilibre entre souveraineté et autodétermination — l’autonomie négociée comme forme moderne d’autodétermination.
Bien avant que Washington ne s’engage dans cette voie, le MSP plaidait déjà pour une solution consensuelle et partagée, perçue non pas comme un renoncement, mais comme un acte de maturité politique.
Cette position, qui gagnait d’abord en crédibilité dans les cercles diplomatiques africains et européens, trouve aujourd’hui un écho direct dans la terminologie du projet américain.
Une approche convergente avec la diplomatie onusienne
Depuis la nomination de Staffan de Mistura, les Nations unies cherchent à réintroduire les acteurs alternatifs dans le processus politique, après des décennies de bipolarisation entre Rabat et le Polisario.
Le MSP s’inscrit parfaitement dans cette dynamique : il incarne la pluralité interne du peuple sahraoui, tout en proposant une feuille de route compatible avec les principes de l’ONU.
Son approche — autonomie négociée sous garantie internationale — rejoint les orientations de réalisme inclusif prônées par plusieurs membres permanents du Conseil.
De plus, le MSP a su établir des canaux de dialogue avec les chancelleries occidentales, africaines et latino-américaines, plaidant pour que la paix au Sahara occidental soit conçue comme un pilier de stabilité du Maghreb et du Sahel.
À travers ses forums, ses lettres au Secrétaire général de l’ONU et ses déclarations publiques, le mouvement a donné une voix à cette majorité silencieuse de Sahraouis qui aspirent à la dignité, à la participation et à la sécurité, plus qu’à la rhétorique de la confrontation.
Un enjeu régional et générationnel
Le débat de ce 30 octobre ne se résume donc pas à un simple vote technique sur la MINURSO.
Il s’agit d’un réalignement profond des priorités internationales : comment concilier justice historique, stabilité régionale et aspirations populaires ?
Dans cette équation, le rôle du MSP devient crucial. En défendant une autonomie réelle, dans le respect des droits politiques et culturels des Sahraouis, le mouvement ouvre une voie vers une réconciliation régionale durable.
Il redonne aussi aux nouvelles générations sahraouies un horizon : celui de vivre et travailler dans leurs villes natales, Laâyoune, Dakhla, Smara, dans la paix et la dignité.
Vers la fin d’un cycle historique
Si le projet de résolution américain venait à être adopté, même sous une forme amendée, il consacrerait la fin du paradigme de la confrontation totale et le début d’une ère de réalisme constructif.
La convergence entre le plan marocain, l’initiative américaine et la vision sahraouie du MSP ouvre la possibilité d’un nouveau pacte politique, fondé sur la participation, la reconnaissance et la stabilité.
Le Sahara occidental pourrait ainsi cesser d’être le champ clos des rivalités géopolitiques pour devenir un laboratoire de coopération régionale, où la souveraineté, l’autonomie et la paix s’articulent autour d’un même objectif : le bien-être des populations sahraouies.
Entre les lignes des discours diplomatiques, un fait s’impose : le réalisme sahraoui du MSP n’est plus une utopie marginale, mais la traduction vivante de ce que le monde cherche désormais — une paix juste, négociée et inclusive.
Par Hamoud Ghaillani – 30 octobre 2025


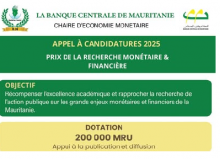



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)